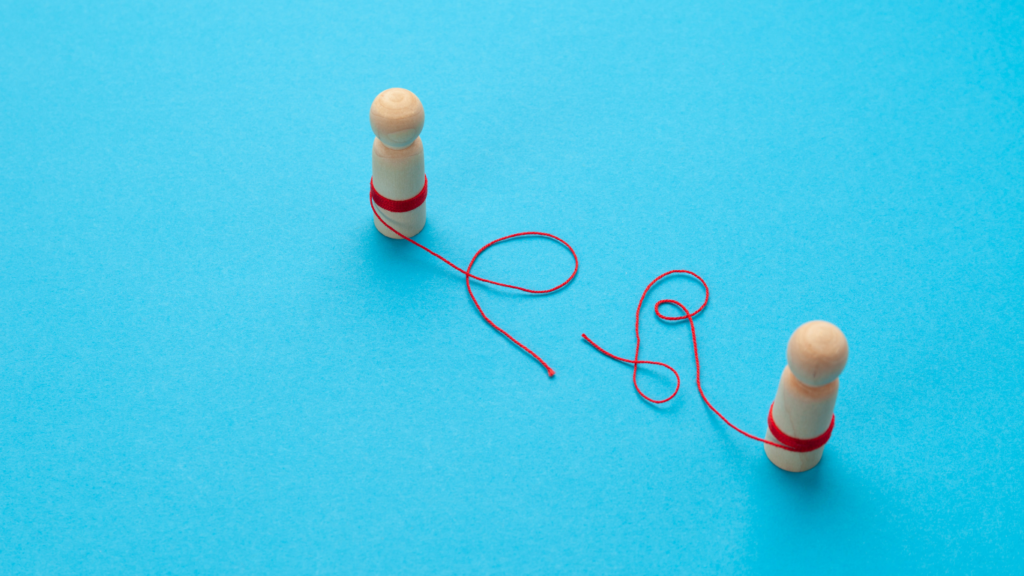
Cet article analyse les dynamiques inconscientes à l’origine de la rencontre amoureuse et de la formation d’un couple. Il met en lumière l’influence des conflits intérieurs, des projections et des schémas familiaux dans le choix du partenaire. L’engagement et le désir sont abordés sous l’angle psychanalytique, soulignant les défis d’une relation durable.
Qu’est-ce qui permet à la rencontre de deux personnes de former un couple ?
Passez une heure dans la rue d’une grande ville et interrogez les passants. Tout le monde aura un avis sur la question. Et cela parce que la rencontre, le couple, sont des thématiques universelles et accrocheuses. L’accroche, pour ma part, aurait été de répondre, en première intention : « lorsque les deux personnes en ont envie. Lorsqu’elles s’y autorisent, lorsque l’idée de l’engagement ne les fait pas partir en courant ». Et pourquoi auraient-ils peur ?
Entre rencontre amoureuse et rencontre de soi
« Est-ce que tout commence toujours par ce désarroi ? L’amour (…) ? Cette effraction en soi de l’autre » (Dufourmantelle, 2012, p 13). Parce qu’en effet, la rencontre n’est rien que cet autre que l’on retrouve en soi. « Ce n’est pas sans raison que l’enfant au sein de la mère est devenu le prototype de toute relation amoureuse. Trouver l’objet sexuel n’est, en somme, que le retrouver » (Freud, 1962, p 129) disait Freud dans ses trois essais sur la théorie sexuelle. Ne serait-ce pas effrayant ? Cette idée que l’on ne serait choisi par quelqu’un, que l’on déciderait de faire couple avec lui non pas pour qui l’on est, notre personnalité pétillante, nos boucles blondes, notre humour décapant ? Mais parce nous résonnons en lui à en faire vibrer ses conflits infantiles, là, tout au fond de son inconscient, à lui permettre de rejouer son lien avec son premier objet d’amour, à lui permettre de se défendre d’un retour du refoulé qui serait trop difficile à gérer psychiquement et, qui sait, si tout se passe bien, à lui permettre de s’apaiser, de s’asseoir sur une assise psychique plus stable et transcendée. Seulement n’oublions pas : comme l’a bien décrit P. Robert dans son article La constitution du couple, si nous sommes choisi pour être l’objet de quelqu’un, l’objet a également son mot à dire et donc « l’Autre ne peut être réduit à l’Objet ».
L’engagement, clé de voûte du couple
Pour en revenir à ma réponse un peu naïve au micro-trottoir sur la question de l’engagement, si nous reprenons le Triangle de l’amour de Sternberg, un amour accompli est équilibré entre l’Intimité, la Passion et l’Engagement. Cette décision de s’investir dans une relation est, selon moi, la composante charnière permettant à la rencontre de deux personnes de faire couple. En effet, dans nos société actuelles, basées sur le plaisir à portée de main, le choix infini, le doute, la libération de la parole, la recherche de proximité, il me semble plus facile d’établir des liens de complicité s’apparentant à de l’Intimité, d’avoir des relations sexuelles et passionnées que de les faire perdurer et les développer avec la même personne.
Jean-G. Lemaire pose d’ailleurs une grande différence sur les processus inconscients intervenant sur le choix d’Objet selon que celui-ci sera destiné à une relation éphémère de satisfaction immédiate d’un besoin ou à « une contribution à l’équilibre personnel et à l’organisation défensive du Moi en face d’un ensemble pulsionnel jamais totalement contrôlé » (Lemaire, 1986, p 55).
Ce qui nous amène directement au rôle de l’inconscient dans la rencontre.
Le rôle de l’inconscient dans la rencontre amoureuse
Le choix amoureux : une défense inconsciente
« Notre inconscient va nous faire « choisir » celui ou celle qui va maintenir le statu quo » (Prieur, 2021, p 91). Cela fait écho à la phrase citée précédemment et la notion de défense. Comment est-il possible d’être choisi (et de choisir en retour) sur une base inconsciente défensive, un « emboîtement défensif » (Robert, p 31) ? L’amour n’est-il pas sensé être sécurisant, protecteur justement ?
De manière tout à fait caricaturale expliquons que, lors d’une structuration psychique dite normale, la construction du Moi passe par des conflits internes infantiles (c’est, par exemple, le bien connu complexe d’Oedipe). Il restera en général des pulsions « mal intégrées ». Celles-ci seront refoulées et des mécanismes de défenses bien installés afin de lutter contre leur retour.
Évoluant bon an mal an dans notre vie, si tant est que nous ne souhaitions pas une relation éphémère (J-G Lemaire), nous choisirions un partenaire « destiné à éviter que cette tendance inconsciente refusée soit stimulée (Sommantico, p 160). Il s’agirait de rechercher chez l’autre des caractéristiques renforçant nos mécanismes de défense.
Notre partenaire comme bouclier défensif
La notion de collusion établie par J. Willi en 1975 va encore plus loin en déclarant comme une force d’attraction inconsciente mutuelle le fait que, lors d’une rencontre, deux personnes vont inconsciemment se reconnaître un conflit intérieur commun et se choisiront parce que chacun, individuellement, y réagit différemment. Ainsi, l’autre, de par sa manière différente de réagir, représentera un bouclier défensif au retour du refoulé. Il est important de garder à l’esprit que ce processus est commun voire normal. En effet, la fonction positive du couple est, d’un point de vue psychanalytique, de permettre aux individualités de « dépasser » certains conflits psychiques, par la même, de dépasser la pulsion d’agression et la culpabilité qui y est liée. Cela lui permettant de s’apaiser et de s’asseoir sur des bases psychiques plus élaborées. Cette collusion peut également avoir un revers négatif à travers, entre autre, ce que R. Kaës appelle le « pacte dénégatif » et d’autres aspects que nous développerons plus après.
Ainsi, il sera nécessaire, tout au long de la vie conjugale, d’avoir une souplesse psychique pour ne pas cristalliser ce phénomène. P. Robert exprime cela dans son article « Les liens du couple » comme le fait qu’« il y a un barrage commun aux matériaux refoulés avec des petits « lâchers d’eau » qui permettent d’en jouir avec précaution pour préserver l’écologie conjugale » (Robert, p 161).
Selon J-G. Lemaire, en cas par exemple de problèmes de sexualité dans le couple, remonter au choix amoureux peut être un levier de travail. « La dysfonction sexuelle doit souvent être considérée comme un effet systémique (…), il devient intéressant et important au point de vue thérapeutique de comprendre comment s’est organisé le choix réciproque des partenaires » (Lemaire, 1986, p 123).
Selon ce développement, le système défensif inconscient paraît être essentiel dans la rencontre de deux personnes qui vont faire couple. Mais également, au-delà des caractéristiques de l’Objet en lui-même, ce qui fera force dans le choix inconscient du partenaire est la relation que l’on a avec l’Objet et sa notion de répétition. « Finalement, ce qui se répète dans l’amour, ce sont les conditions de son apparition ; c’est l’acte de naissance des fantômes » (Gaudillière dans Dufourmantelle, 2012, p 25).
La dimension narcissique dans la création du couple
Intervient dans cette relation à l’Objet, une dimension narcissique. J-G. Lemaire étaye cela au travers des notions kleiniennes de clivage et d’idéalisation. Dans la structuration de la relation de l’enfant à l’Objet, celui-ci va commencer par un clivage en mauvais et bon objet. De la même manière, nous retrouverons à l’âge adulte cette idéalisation du bon Objet dans les premiers temps de la relation amoureuse. En effet, afin qu’il soit gratificateur, l’individu va projeter sur son conjoint tous les aspects positifs que peuvent lui amener le bon Objet. Ce mécanisme permet en retour, une réassurance narcissique puisqu’« aimer le bon Objet, c’est être nous-même le bon Objet » (Lemaire, 1986, p 93).
Le couple : entre répétition de schémas familiaux et création
Cette notion fait donc intervenir un aspect fondateur : la relation filiale. En effet, selon R. Kaës, il y aurait deux dimensions intervenant dans le lien à l’Objet : la répétition de ce que les partenaires ont vécu dans leur famille réciproque, notamment de ce qu’ils ont vu du couple parental et une nouveauté, quelque chose à créer qui serait liée à la rencontre de l’altérité. Ainsi, si « toute affiliation se fonde sur les failles de la filiation » (Granjon dans Robert, p 161), la rencontre créera une péninsule de projections que chacun des partenaire aura à s’approprier pour le faire évoluer. La rencontre de deux individus, au-delà de leurs inconscients déjà chargés, met en scène bien d’autres acteurs qui tournent en arrière fond. « Lorsqu’on fait couple, se rajoutent aux loyautés familiales, les loyautés du couple » (Prieur, 2021, p 91). Poids lourd qui attend ces individus qui se mettent en couple mais il s’agit pour eux d’être un atout pour évoluer et, comme on le notait plus haut, pouvoir s’asseoir sur une base psychique plus apaisée. Car si la répétition peut aliéner, elle permet aussi dés échappatoires. « Selon Kierkegaard, la répétition est une naissance au second degré qui se fonde sur une transcendance » (Dufourmantelle, 2012, p 33).
De la réussite de la rencontre
Pour que la transcendance opère chez l’individu, il s’agirait pour lui d’être suffisamment sécure à ce moment là. En effet, une personne peut enchaîner les relations difficiles, pauvres, qui « ne lui servent à rien » pendant longtemps s’il est en proie à une forte « insécurité ontologique » qu’il aurait du mal à dépasser. Ce concept introduit par J-G. Lemaire envisage qu’il faut avoir un self bien construit et un solide sentiment de son existence pour que le partenaire choisi et la relation conjugale construite soient transcendants. C’est à présent qu’apparaissent les problèmes rencontrés par le couple du fait de l’intervention de l’inconscient dans sa création.
Le rôle de l’inconscient dans l’évolution du couple
La phase de lune de miel : en sortir ensemble
« Le lien nous aliène ou nous soutient » (Robert, p 160) selon P. Robert. Ainsi par exemple, reprenons la part du narcissisme dans la rencontre. Comme expliqué plus avant, selon le concept de clivage, l’individu idéalisera dans un premier temps son conjoint durant ce que l’on appelle la phase de lune de miel. Seulement voilà, la lune de miel n’est pas éternelle et arrivera bien un moment où le mauvais objet repointera le bout de son nez, en général lors d’une première crise ou lorsque le partenaire ne réagira pas comme l’autre l’attendrait. Il s’agira alors d’être capable de continuer à l’aimer même lorsque l’on découvrira de l’hostilité à son égard. En effet, apparaîtra ici l’ambivalence. Car chaque objet est ambivalent. Et il s’agira pour l’individu d’avoir la « capacité de vivre l’équivalent du deuil » (Lemaire, 1986, p 74) pour accepter l’arrivée de l’ambivalence chez son conjoint ce qui, par là même, lui réattribue également ses mauvais côtés. Mauvais côtés qui, rappelons le, ont pu être mis en suspens durant la phase de lune de miel. Celle-ci serait d’ailleurs « la seule expérience existentielle qui puisse avoir une valeur maturante sans caractéristiques de frustration » (Lemaire, 1986, p 164). Lorsque cette acceptation est impossible et que, par exemple, l’autre est entièrement l’Idéal du Moi de son partenaire (celui qu’il voudrait être), il sera rejeté d’un bloc, sans préavis ni retour possible.
Des mécanismes d’idéalisation du partenaire
Ceci n’est qu’un exemple de la manière dont l’inconscient va faire rencontrer des problèmes au couple. Si l’on revient au choix du partenaire et à la part belle du narcissisme, nous pouvons en citer d’autres (hors cas pathologiques). L. Wynne a introduit la notion d’« échange des dissociations » (Lemaire, 1986, p 124). Il envisage la possibilité qu’un individu souhaite « mettre de côté » certaines de ses caractéristiques personnelles qu’il considère comme désagréables ou coupables. Pour cela, il les projettera sur son partenaire. Ce processus réciproque nous montre que la rencontre et le passage en couple s’est basé sur une dyade organisée où chacun des partenaire a reconnu en l’autre ses propres défaillances. Certaines personnes, n’étant pas capable de supporter l’ambivalence qu’ils savent appartenir à l’Objet (et donc à soi), ne souhaiteront le voir que partiellement, dans certaines organisations, afin de toujours maintenir le côté qui les satisfait et ne pas risquer d’en avoir une déception. Il pourra également s’agir, par exemple, de choisir un partenaire auquel on laissera une part de mystère, dont on ne voudra pas tout savoir en espérant que les défauts resteront cachés. Pourtant, N. Prieur affirme qu’« un couple devient un lieu sécurisant,(…), quand il permet à chacun d’accueillir cet inconnu de soi » (Prieur, 2021, p 110). Il s’agirait de ne pas supposer que c’est parce qu’on aime l’autre qu’on le connaît. Cette proposition ne doit pas entrer dans le même registre. En effet, dans le premier cas, la personne nie la « part négative » de son conjoint comme défense projective contre le processus maturatif de deuil du bon objet. Alors que, selon la citation de N. Prieur, il s’agirait ici d’éviter la fusion et de cultiver l’altérité nécessaire justement à l’épanouissement du couple.
L’alliance inconsciente : évolution ou enfermement du couple ?
Revenons donc au couple « normalement » constitué selon le lien inconscient. « Freud n’a jamais réduit la relation amoureuse aux seules nécessités de l’équilibre narcissique (…) il en a au contraire lui-même bien souligné l’ambivalence » (Lemaire, 1986, p 93). La rencontre de deux individus est la rencontre de l’altérité, donc de la nouveauté, mais également celle de leur filiation et de leurs failles inconscientes respectives. Dans ce cas se créé, selon le terme donné par R. Kaës, une « alliance inconsciente du couple ». Il s’agit d’un « accord inconscient soutenant la constitution du lien et son maintien » (Robert, p 33). S’il a une fonction positive comme on a pu le voir, il a également son revers.
Le « pacte dénégatif » est un enfermement dans l’alliance. Si celle-ci représente au départ une économie psychique certaine voire une totale « béatitude » inconsciente lors de la phase de lune de miel, les choses reprennent vite leur place et « que l’on s’allie pour consolider la censure ou ses propres forces de refoulement, ou que l’on espère transformer les éléments bruts indésirables (…), chacun attend quelque chose du Nous » (Robert, p 33). L’appareil psychique doit donc s’en tenir à l’alliance. Le prix en serait la méconnaissance de ce que chacun met en jeu dans le lien, et par là-même, son évolution possible.
Qu’en est-il du désir ?
A la lumière de ce qui a été présenté ici, on pourrait avoir cette impression que finalement, presque rien ne nous appartient dans le choix de notre partenaire et la constitution du couple. Et pourtant nous y amenons un bagage infini, celui de notre filiation, mêlé à toute notre histoire infantile. Bien sûr, ne négligeons pas les aspects sociétaux et culturels.
Que reste-t-il de notre désir ? Comme évoqué dans la première question sur ce qui fait que l’on devient un couple, nous pouvons revenir sur la question du désir. Le désir aujourd’hui est partout. Comme l’exprime W. Pasini dans son ouvrage sur la force du désir, dans notre société actuelle, celui-ci s’est plutôt galvaudé en plaisir instantané, rapide et immédiat. Entraînant peut-être plus de relations éphémères. Dans cette rhétorique, nous pourrions rapprocher ici le désir d’un engagement et le fait qu’« une bataille sourde entre conscient et inconscient alimente sans cesse l’ambiguïté de nos désirs » (Prieur, 2021, p 90). Faire couple ne relèverait-il pas d’un véritable défi ?
Rachel Sturtzer
